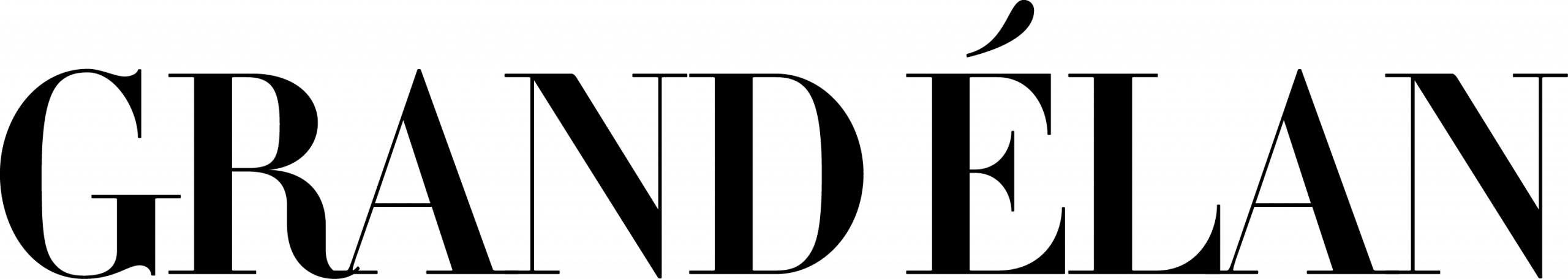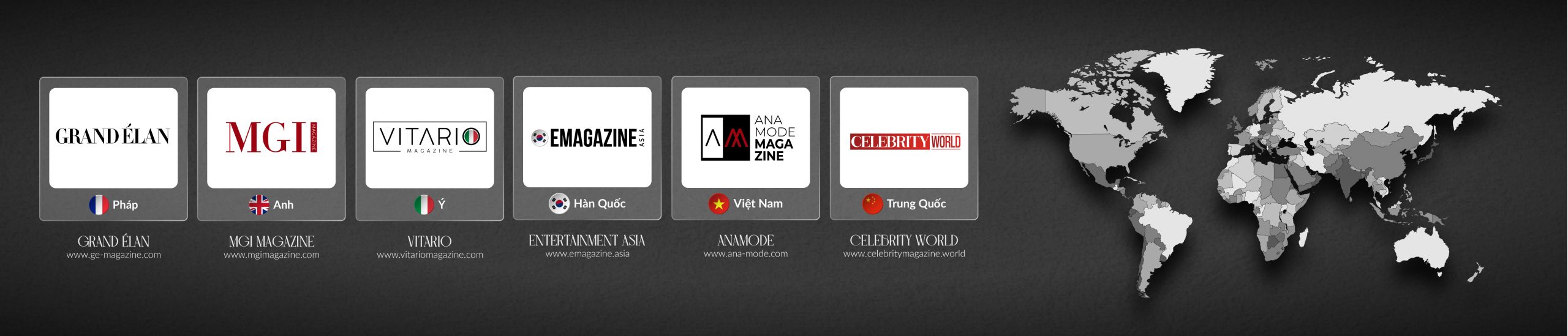Presque deux décennies après le premier volet culte, Le Diable s’habille en Prada fait son grand retour au cinéma. Alors que les premières images du tournage ont fuité, une chose saute aux yeux : le style est plus affûté que jamais. Entre come-back iconiques, clins d’œil vintage et nouvelles icônes de mode, cette suite s’annonce déjà comme un manifeste fashion d’envergure. De New York à Paris, de Dior à Coach, décryptage des silhouettes qui feront parler d’elles bien avant la sortie en salle.
Un héritage mode savamment réinventé
Ce qui frappe d’emblée dans ces premiers clichés, c’est la façon dont la production joue avec l’héritage visuel du film original. Andy Sachs, incarnée à nouveau par Anne Hathaway, arbore un costume rayé audacieux, porté avec une chemise blanche oversized, des boots Golden Goose et un sac Coach. Une silhouette qui évoque subtilement sa métamorphose stylistique du premier opus, tout en affirmant une autorité nouvelle, celle d’une femme qui maîtrise désormais les codes.
Miranda Priestly, quant à elle, réapparaît dans un manteau structuré, ceinturé, et de nouvelles lunettes solaires, incarnation d’une élégance tranchante face à la crise des médias. Le personnage semble désormais confronté à un monde où le papier cède face au numérique, mais sa présence visuelle reste aussi imposante qu’auparavant. Son look parle avant elle : autorité, contrôle, et une intemporalité redoutablement chic.

Une nouvelle génération d’icônes prend la relève
À côté des figures emblématiques, le casting s’étoffe avec de nouveaux visages porteurs d’une esthétique fraîche. L’actrice Helen J Shen, par exemple, incarne une jeunesse urbaine et effervescente dans des pièces à la coupe audacieuse, mixant transparence et tailoring oversize. Pauline Chalamet apporte une touche décalée avec une jupe taille haute, un débardeur graphique et des accessoires vintage qui rappellent les influences des années 2000.
Simone Ashley, star montante aperçue dans les ruelles new-yorkaises en trench fluide et sac structuré, confirme quant à elle sa stature de nouvelle it-girl. Elle incarne une féminité affirmée, contemporaine, qui n’hésite pas à jouer sur les contrastes. Chaque apparition de ces nouvelles recrues est pensée comme une déclaration d’intention : le futur de la mode se conjugue au présent.

Le costume au cœur de la narration stylistique
Élément récurrent sur le plateau, le costume s’impose comme pièce clé de cette suite. Andy, notamment, est photographiée dans un modèle Jean Paul Gaultier vintage, aux épaules marquées et coupe croisée, rappelant le pouvoir du tailoring dans la narration féminine. Associé à un sac Coach et des escarpins nude, le look tranche avec son style naïf du premier film : on découvre une femme stratège, assurée, au sommet de sa trajectoire.
Stanley Tucci, dans le rôle de Nigel, affiche pour sa part un costume monochrome immaculé, stylisé avec des lunettes fumées et une pochette contrastante. Une silhouette qui incarne la constance du personnage dans un monde en perpétuelle mutation. Le costume, ici, devient bien plus qu’un uniforme : c’est une armure élégante dans la jungle de la mode contemporaine.

Mode et narration : quand chaque look raconte une histoire
Ce nouveau volet confirme ce que le premier avait amorcé : la mode n’est pas qu’un ornement, elle est un langage. Chaque tenue, chaque accessoire, chaque chaussure participe à la construction des personnages. Ainsi, Andy est aussi crédible en robe Gabriela Hearst qu’en costume d’homme, Meryl Streep fascine autant par son jeu que par ses escarpins affûtés, et les apparitions de seconds rôles sont autant de fragments stylistiques qui enrichissent l’intrigue.

Entre clins d’œil à l’histoire de la haute couture et placements subtils de marques contemporaines, Le Diable s’habille en Prada 2 se positionne déjà comme un objet mode à part entière. Les costumes, orchestrés par une équipe de stylistes visionnaires, prolongent les thèmes du film — transformation, pouvoir, survie — tout en réaffirmant que la mode, lorsqu’elle est bien pensée, est toujours une histoire de personnalité.