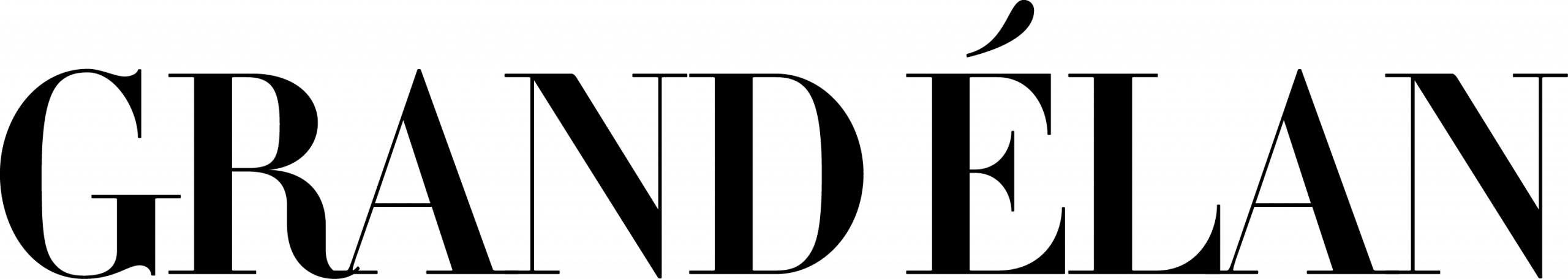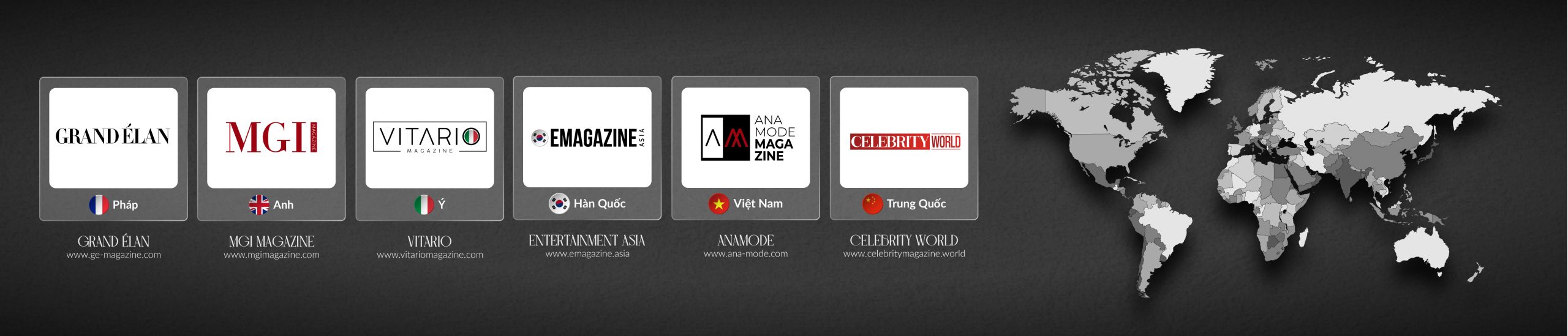Le sarong, vêtement traditionnel d’Asie du Sud-Est, s’impose comme la tendance masculine phare de l’été 2026. Réinventé par des créateurs comme Julian Klausner pour Dries Van Noten, Craig Green ou Niccolò Pasqualetti, il se décline sur les podiums dans des versions modernes, colorées et audacieuses. Entre clin d’œil aux icônes des années 1990-2000 et jeux de superpositions raffinées, cette pièce polyvalente promet de bousculer les codes vestimentaires masculins et d’apporter une touche d’exotisme assumé aux silhouettes estivales.
 es podiums
es podiums
Lors de la Fashion Week homme printemps-été 2026, le sarong a marqué les esprits grâce à l’audace de Julian Klausner, nouveau directeur artistique de Dries Van Noten. Fidèle à l’héritage vibrant et coloré du fondateur, le créateur a proposé une collection mêlant vêtements formels et accessoires décontractés. Sur le podium, les carrés de soie noués à la taille côtoyaient pantalons cargo et costumes impeccables, offrant une interprétation contemporaine du sarong.
Ce choix stylistique traduit une volonté d’ouvrir de nouvelles perspectives à la mode masculine. Le sarong, longtemps perçu comme un vêtement exclusivement traditionnel ou balnéaire, se retrouve ici projeté dans un univers urbain et sophistiqué. La juxtaposition des matières, l’explosion de couleurs et les motifs mix and match témoignent d’un désir de fusionner cultures et époques dans une même silhouette.

Des créateurs qui osent la superposition
Le phénomène ne se limite pas à Dries Van Noten. Craig Green, figure subversive du vestiaire masculin, a fait son grand retour au calendrier officiel parisien en misant également sur cette pièce. Il l’a intégrée à des silhouettes expérimentales, jouant sur la superposition et le contraste entre tradition et avant-garde. Le jeune créateur italien Niccolò Pasqualetti a, lui aussi, revisité le sarong en explorant ses multiples formes et usages.
Ces approches démontrent que le sarong n’est plus seulement un accessoire saisonnier, mais un élément de style à part entière. En le combinant à des vêtements structurés ou à des pièces utilitaires, les designers lui confèrent une nouvelle identité. L’objectif : séduire un public en quête d’originalité tout en valorisant une pièce riche en héritage culturel.
Des inspirations venues des années 1990-2000
La résurgence du sarong puise aussi dans une nostalgie assumée. Les images d’archives de Matthew McConaughey en 2001, vêtu d’un sarong et d’un tee-shirt noir lors d’une soirée à Toronto, ont récemment enflammé les réseaux sociaux. Son audace vestimentaire, ponctuée d’une paire de tongs, semble résonner avec l’esprit libre des collections actuelles. Les mêmes sandales sont d’ailleurs apparues sur le podium de Dries Van Noten cette saison.
Ce n’est pas un cas isolé : David Beckham avait déjà marqué les esprits en 1998 en arborant un sarong aux côtés de Victoria Beckham. Ces clins d’œil aux icônes passées nourrissent l’imaginaire des créateurs et renforcent l’aura rétro de la tendance. Ils rappellent aussi que certaines pièces, longtemps marginales, peuvent revenir sur le devant de la scène avec éclat.
Une tendance aux racines anciennes
Si le sarong s’affiche aujourd’hui dans un registre résolument mode, il ne s’agit pas de sa première incursion dans les défilés occidentaux. Au printemps-été 2019, Paco Rabanne et Oscar de la Renta avaient déjà présenté leur propre interprétation, dans une esthétique bohème et fluide. Cette première vague avait préparé le terrain pour l’essor actuel, même si l’ampleur médiatique était moindre.
L’intérêt renouvelé pour le sarong témoigne d’une volonté plus large de diversifier les codes vestimentaires masculins. En mêlant histoire, tradition et modernité, il incarne une approche inclusive et créative de la mode. Sa capacité à traverser les époques et à s’adapter aux tendances en fait un candidat idéal pour s’installer durablement dans les garde-robes, bien au-delà de l’été 2026.